Légionellose spa : est-ce qu'il y a un risque ?
Vous adorez vous détendre dans votre spa après une longue journée, mais vous avez entendu parler de cas de légionellose liés aux bains à remous ? Cette préoccupation est légitime. La bactérie legionella peut transformer un moment de relaxation en danger pour la santé, particulièrement dans les installations mal entretenues. Voici ce qu'il faut absolument savoir :
- La légionellose est une infection pulmonaire grave causée par la bactérie legionella pneumophila, qui prolifère naturellement dans les milieux aquatiques
- Les spas présentent un terrain favorable à la multiplication de ces bactéries en raison de leur température chaude et de leur eau fortement agitée
- La contamination se fait par inhalation de microgouttelettes d'eau contaminée, pas par contact direct
- Certaines personnes sont plus vulnérables : fumeurs, personnes âgées de plus de 50 ans, individus avec un système immunitaire affaibli
- Un entretien rigoureux permet de prévenir les risques en maintenant une désinfection appropriée et une hygiène irréprochable
Cet article vous explique comment la légionellose se développe, quels sont les véritables risques liés aux spas, et surtout comment profiter de votre installation en toute sécurité.

Comprendre la légionellose et son origine
La légionellose reste méconnue du grand public malgré les 1600 à 2000 cas recensés chaque année en France par Santé Publique France. Cette maladie infectieuse représente pourtant un enjeu majeur de santé publique, avec un taux de mortalité non négligeable lorsque le diagnostic et le traitement antibiotique tardent. Comprendre la nature de cette infection, ses origines historiques et ses différentes formes permet d'appréhender correctement les risques associés aux installations aquatiques, notamment les spas.
Qu'est-ce que la légionellose ?
La légionellose est une infection respiratoire aiguë causée par la bactérie legionella pneumophila, un micro-organisme présent naturellement dans les eaux douces. Cette maladie infectieuse affecte les poumons et peut s'avérer particulièrement grave, avec un taux de mortalité compris entre 10 et 15% en absence de traitement antibiotique rapide. La bactérie legionella appartient au genre legionella, qui compte plusieurs espèces, mais l'espèce legionella pneumophila reste la plus fréquemment associée aux cas d'infection pulmonaire chez l'être humain.
La contamination se produit lorsqu'une personne inhale des aérosols d'eau contaminée, ces fameuses microgouttelettes en suspension dans l'air. Contrairement à certaines idées reçues, la légionellose ne se transmet pas de personne à personne – sauf un cas exceptionnel documenté dans la littérature médicale. L'infection peut aussi survenir par aspiration d'eau contenant la bactérie, notamment chez les patients hospitalisés. Le ministère de la santé et Santé Publique France recensent entre 1600 et 2000 cas par an en France, un chiffre probablement sous-estimé compte tenu des difficultés de diagnostic.
Comment la maladie a-t-elle été découverte ?
L'origine du nom "maladie du légionnaire" remonte à une épidémie qui a marqué l'histoire de la santé publique. En 1976, lors d'une convention de l'American Legion (association d'anciens combattants américains) à Philadelphie, 182 participants ont développé une pneumonie mystérieuse. L'enquête sanitaire menée par les autorités américaines a révélé que 29 personnes sont décédées de cette infection pulmonaire dont la cause était alors inconnue. Les équipes scientifiques ont finalement identifié la bactérie responsable dans le système de climatisation de l'hôtel qui hébergeait la convention.
Cette découverte a permis de mettre en lumière le rôle des installations de refroidissement et des réseaux d'eau chaude sanitaire dans la transmission de la maladie. Depuis, la gestion du risque lié aux légionelles fait l'objet d'une réglementation stricte, particulièrement dans les établissements de santé et les hôtels. L'Institut Pasteur et l'Agence Régionale de Santé coordonnent aujourd'hui la surveillance épidémiologique et la prévention du risque lié à cette bactérie. Des épidémies récentes comme celle du Pas-de-Calais en 2003, avec près de 90 cas et 17 décès liés à des tours de refroidissement, rappellent que le danger reste présent.
Différences entre fièvre de Pontiac et légionellose pulmonaire
La bactérie legionella peut provoquer deux formes distinctes de maladie selon le type d'atteinte et la gravité des symptômes. La fièvre de Pontiac représente la forme bénigne de l'infection : elle se manifeste par un syndrome pseudo-grippal avec de la fièvre, des douleurs musculaires et un malaise général, mais sans atteinte respiratoire grave. Cette forme guérit spontanément en quelques jours sans nécessiter de traitement antibiotique spécifique, et ne présente pas de risque de décès.
À l'inverse, la légionellose pulmonaire constitue la forme sévère de la maladie. Elle se caractérise par une pneumonie aiguë avec une insuffisance respiratoire potentiellement mortelle. Les symptômes apparaissent après une période d'incubation comprise entre 2 et 10 jours suivant l'exposition à la source de contamination. Cette forme nécessite une prise en compte médicale urgente et un traitement antibiotique adapté. Sans intervention rapide, l'infection peut évoluer vers des complications graves, notamment une insuffisance rénale ou des troubles neurologiques pouvant mener au coma.
Conditions de développement de la bactérie
La prolifération des légionelles dans les installations hydrauliques ne relève pas du hasard mais répond à des conditions environnementales précises. La température de l'eau, la stagnation, la présence de nutriments organiques et les caractéristiques du réseau créent un écosystème plus ou moins favorable à la multiplication bactérienne. Le réchauffement climatique vient aujourd'hui modifier ces paramètres et complexifier la gestion du risque sanitaire dans de nombreuses installations.
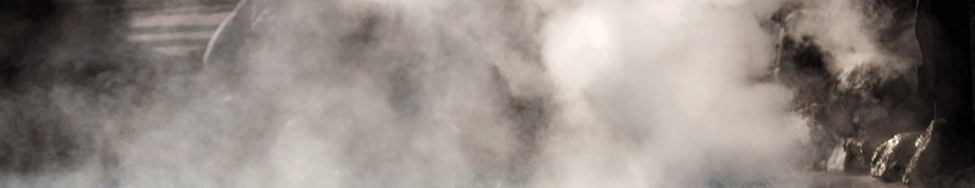
Températures favorables et environnements propices
La bactérie legionella pneumophila se développe dans une plage de température comprise entre 15°C et 50°C, avec une zone optimale de prolifération située entre 30 et 45°C. Cette particularité thermique explique pourquoi les réseaux d'eau chaude sanitaire représentent un terrain favorable à sa multiplication. Dans les installations domestiques et collectives, la stagnation de l'eau dans les tuyauteries peu utilisées crée des conditions idéales pour le développement bactérien, surtout lorsque la température de l'eau se situe dans cette fourchette dangereuse. Les tours de refroidissement, les climatiseurs mal entretenus, les pommeaux de douche, les jacuzzis et les réservoirs d'eau chaude constituent autant de sites où l'alimentation en eau peut devenir une source de contamination.
Au-delà de la température, plusieurs facteurs environnementaux favorisent la prolifération des légionelles. La présence de dépôts organiques (biofilm, tartre, rouille) dans les canalisations offre des nutriments et un support physique pour la croissance bactérienne. Les légionelles vivent naturellement dans les eaux douces et les milieux aquatiques, où elles colonisent les protozoaires comme les amibes. Cette vie intracellulaire les protège des conditions défavorables et des traitements de désinfection standards, rendant leur élimination particulièrement complexe dans les installations contaminées.
Rôle du réchauffement climatique
Le réchauffement climatique modifie profondément les conditions de développement des légionelles dans l'environnement. Les canicules à répétition augmentent la température des réseaux d'eau, notamment dans les bâtiments mal isolés où les canalisations sont exposées à la chaleur. Cette élévation thermique crée davantage de zones où la température de l'eau se situe dans la fourchette favorable à la multiplication bactérienne. Le ministère de l'écologie et du développement durable a d'ailleurs alerté sur ce risque sanitaire émergent lié au changement climatique.
Les inondations, dont la fréquence augmente avec les dérèglements climatiques, constituent également un facteur aggravant. Ces épisodes perturbent les réseaux de distribution d'eau et créent des zones de stagnation où les bactéries peuvent proliférer massivement. L'eau contaminée peut alors pénétrer dans les installations individuelles et collectives. La gestion du risque légionellose doit désormais intégrer ces nouvelles données climatiques, particulièrement dans les établissements recevant du public et les réseaux d'eau potable.
Comportement de Legionella pneumophila en milieu aquatique
La bactérie legionella présente des caractéristiques biologiques qui expliquent sa persistance dans les installations hydrauliques. Contrairement à d'autres bactéries comme escherichia coli, elle possède une capacité remarquable à survivre dans des conditions difficiles. Son mode de vie intracellulaire, nichée dans les amibes et autres protozoaires, lui confère une protection naturelle contre de nombreux biocides et procédés de désinfection. Cette résistance complique la gestion du risque dans les réseaux d'eau, qu'ils soient d'eau froide ou d'eau chaude.
La formation de biofilm sur les parois des canalisations représente un autre défi majeur. Ces dépôts organiques servent de réservoir à la bactérie et la protègent des traitements chimiques. La bactérie se développe lentement mais de manière continue dans ces niches écologiques, colonisant progressivement l'ensemble du système hydraulique. Les points de stagnation, comme les bras morts dans les tuyauteries ou les ballons d'eau chaude mal dimensionnés, constituent des zones à haut risque où la concentration bactérienne peut atteindre des niveaux dangereux.
Symptômes et complications possibles
Les symptômes de la légionellose apparaissent après une période d'incubation comprise entre 2 et 10 jours suivant l'exposition à l'eau contaminée. La maladie débute généralement par des signes pseudo-grippaux : fièvre élevée, malaise général, perte d'appétit et douleurs musculaires intenses. Rapidement, une toux sèche s'installe, accompagnée de douleurs thoraciques. Le patient peut aussi présenter des troubles digestifs comme des douleurs abdominales, des nausées et des diarrhées, ce qui peut retarder le diagnostic si le médecin ne pense pas immédiatement à une atteinte respiratoire. Ces symptômes non spécifiques rendent le diagnostic complexe, d'où l'importance de mentionner toute exposition récente à un spa, une douche ou un système de climatisation lors de la consultation.
La situation se complique lorsque l'infection pulmonaire progresse vers une forme grave. Le patient développe une détresse respiratoire avec une sensation d'essoufflement croissante et des crachats sanglants peuvent apparaître, signe d'une atteinte sévère du tissu pulmonaire. Les troubles neurologiques constituent une particularité de cette infection : confusion, désorientation, voire coma dans les cas les plus graves. Sans traitement antibiotique approprié administré rapidement, la légionellose peut provoquer une insuffisance rénale et une défaillance multi-organique potentiellement mortelle. Le temps de réaction du service de soin s'avère déterminant : un diagnostic précoce par test PCR ou détection antigénique dans les urines, suivi d'un traitement aux macrolides ou fluoroquinolones pendant 14 à 21 jours, permet généralement d'éviter le décès. Les patients fragiles ou immunodéprimés nécessitent une hospitalisation en réanimation compte tenu de la gravité potentielle de l'infection.
Risques spécifiques liés aux spas
Les spas et bains à remous occupent une place particulière dans l'épidémiologie de la légionellose. Plusieurs épidémies documentées, dont certaines avec des décès, ont été directement associées à l'utilisation de jacuzzis mal entretenus dans des hôtels, des centres de bien-être ou même des installations privées. Ces équipements cumulent l'ensemble des facteurs de risque : température idéale pour la bactérie, production massive d'aérosols, charge organique élevée et désinfection parfois insuffisante face à l'intensité d'utilisation.
Pourquoi les spas sont des foyers à haut risque ?
Les spas et bains à remous cumulent l'ensemble des conditions favorables à la prolifération des légionelles. La température de l'eau, maintenue entre 30 et 40°C pour le confort des usagers, se situe précisément dans la zone optimale de multiplication de la bactérie legionella pneumophila. L'eau fortement agitée par les jets de remous crée en permanence des aérosols et des microgouttelettes en suspension dans l'air ambiant. Ces gouttelettes, lorsqu'elles contiennent des légionelles, peuvent être inhalées directement par les utilisateurs du spa, mais aussi par les personnes se trouvant à proximité du bassin.
La désinfection des spas pose un défi technique majeur. Contrairement aux piscines traditionnelles, l'eau chaude accélère la consommation du chlore et des autres désinfectants. La fréquentation élevée de ces installations apporte une quantité importante de matières organiques : sueur, urines, huiles corporelles, peaux mortes et résidus de cosmétiques. Cette charge organique fait chuter rapidement le niveau de chlore résiduel, laissant la porte ouverte à la prolifération bactérienne. Beaucoup d'exploitants, particulièrement dans les hôtels ou les établissements recevant du public, ne vidangent pas systématiquement les bassins aussi souvent que nécessaire.
Profil des usagers les plus vulnérables
La légionellose ne frappe pas au hasard : certains profils présentent un risque fortement accru de développer la forme grave de la maladie. Les hommes représentent 60 à 70% des cas recensés, pour des raisons qui restent partiellement inexpliquées d'un point de vue scientifique. L'âge constitue un facteur déterminant : les personnes âgées de plus de 50 ans sont particulièrement exposées, leur système immunitaire réagissant moins efficacement face à l'infection. Les fumeurs figurent parmi les populations les plus à risque, car le tabagisme endommage les défenses naturelles des voies respiratoires.
Les individus souffrant de pathologies chroniques doivent faire preuve d'une attention particulière lors de l'utilisation d'un spa. Le diabète, les cancers, les maladies du sang et les troubles respiratoires préexistants fragilisent l'organisme face à l'infection. Les personnes sous traitement immunosuppresseur ou corticothérapie prolongée, notamment après une greffe d'organe, présentent un système immunitaire affaibli qui ne peut combattre efficacement la bactérie. Ces patients doivent consulter leur médecin avant d'utiliser des bains à remous publics et s'assurer que l'exploitant respecte scrupuleusement la réglementation sanitaire applicable.
Pathologies liées à l'utilisation de spas contaminés
Au-delà de la légionellose respiratoire, les spas mal entretenus peuvent provoquer diverses infections. Les folliculites constituent le problème le plus fréquent : ces infections cutanées se manifestent par des boutons rouges et douloureux autour des follicules pileux, causés par des bactéries présentes dans l'eau chaude contaminée. Les infections ORL représentent un autre risque lié à l'utilisation de spas : l'otite externe, aussi appelée "otite du baigneur", survient lorsque l'eau contaminée pénètre dans le conduit auditif. Cette affection douloureuse nécessite un traitement antibiotique local et peut se compliquer en absence de soin approprié.
Les infections génito-urinaires touchent particulièrement les femmes utilisant des spas à l'hygiène douteuse. La chaleur et l'humidité créent un environnement favorable à la multiplication de bactéries pathogènes qui peuvent remonter les voies urinaires. Les troubles gastro-intestinaux constituent également une réalité dans certains établissements où la qualité de l'eau n'est pas correctement contrôlée. L'ingestion accidentelle d'eau contenant des bactéries intestinales comme escherichia coli provoque des diarrhées, parfois sévères. Ces différentes pathologies, bien que généralement moins graves que la légionellose, justifient une vigilance constante sur la qualité sanitaire des spas.
Mesures préventives pour limiter les risques
Pour les propriétaires de spa individuel, un entretien rigoureux constitue la meilleure protection contre la légionellose. Nettoyer les filtres et les parois du bassin chaque semaine permet d'éliminer le biofilm et les dépôts organiques où la bactérie se développe. Le maintien d'un pH optimal de l'eau, compris entre 7,2 et 7,4, garantit l'efficacité du chlore ou des autres désinfectants utilisés. La concentration en chlore doit être vérifiée systématiquement, particulièrement après une utilisation intensive ou une réception où plusieurs personnes se sont baignées successivement. Les fabricants fournissent des recommandations précises pour l'entretien : les suivre scrupuleusement n'est pas une option mais une nécessité pour assurer la sécurité sanitaire. Dans les installations domestiques plus larges, faire couler l'eau régulièrement dans tous les points d'eau peu utilisés – au moins une fois par semaine – empêche la stagnation favorable à la prolifération des légionelles.
Monter la température de l'eau chaude sanitaire à 50-60°C dans le ballon permet de réduire la multiplication bactérienne dans le réseau, tout en faisant attention aux risques de brûlure. Détartrer et désinfecter les pommeaux de douche, les embouts de robinetterie et les flexibles constitue une pratique d'hygiène simple mais efficace. Pour les systèmes de climatisation et les tours de refroidissement, un entretien professionnel régulier s'impose, avec des traitements chimiques appropriés et un contrôle des aérosols produits. Les exploitants d'installations collectives doivent appliquer la réglementation en vigueur et tenir un registre des opérations de maintenance effectuées, document que l'Agence Régionale de Santé peut demander à consulter lors des contrôles sanitaires. La réglementation relative à la prévention impose des obligations par type d'installation, particulièrement strictes pour les établissements recevant du public.
Brome Pastilles Spa Time
Désinfectant Plus SpaTime
Kit entretien spa Brome
Ph plus SpaTime
PH- moins Baisser le pH
Alca-Plus SpaTime
Faut-il éviter les spas ? Recommandations pratiques
Non, il n'est pas nécessaire d'éviter systématiquement les spas, mais il faut adopter une approche raisonnée basée sur la qualité de l'entretien. Pour votre spa personnel, un entretien hebdomadaire avec une filtration adaptée et une désinfection correcte vous permet de profiter de votre installation en toute sécurité. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'eau est claire, sans odeur suspecte ni dépôt visuel sur les parois. Prenez toujours une douche savonneuse avant d'entrer dans le spa pour limiter l'apport de matières organiques. Limitez la durée de vos bains à 15-20 minutes et hydratez-vous correctement pour éviter la déshydratation liée à la chaleur. Dans les établissements publics comme les hôtels ou les centres de thalassothérapie, renseignez-vous sur les pratiques d'entretien avant d'utiliser le spa.
Un exploitant sérieux affiche généralement les résultats des dernières analyses d'eau et dispose d'un registre d'entretien consultable sur le site de l'établissement. Si vous appartenez à une population à risque – plus de 50 ans, fumeur, diabétique, sous traitement immunosuppresseur – discutez avec votre médecin avant d'utiliser des bains à remous publics. En cas de doute sur la propreté d'une installation, mieux vaut renoncer : un moment de détente ne vaut pas le risque d'une infection potentiellement grave. En cas de symptômes respiratoires après utilisation d'un spa – fièvre, toux sèche, douleurs musculaires – consultez rapidement un professionnel de santé en mentionnant cette exposition : un traitement antibiotique précoce peut vous sauver la vie. La prévention du risque lié aux légionelles passe par une prise de conscience collective et une responsabilité partagée entre exploitants et usagers.










